Professeurs de désespoir, de Nancy Huston
A malins, maligne et demie
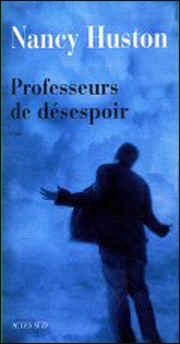 Lorsqu’une des romancières françaises les plus connues ne se contente plus d’écrire des romans - ce pour quoi on l’encense ou du moins la tolère -, mais prétend expliciter, dans un essai, les présupposés et les options philosophiques qui sous-tendent son travail, et qui la mettent en porte-à-faux avec des auteurs chéris par la majeure partie de la critique, elle se retrouve soudain dans une position de quasi marginalité. Star de la fiction, Nancy Huston est, parallèlement, une essayiste « périphérique », au sens qui nous intéresse, c’est-à-dire au sens d’une charge contestataire qui interpelle le « centre » et l’invite à une remise en question. Elle tente d’enfoncer un coin de ce qui, dans la psychologie collective, résiste le plus ; elle s’entête à poser le doigt là où ça coince, à secouer le cocotier de nos réflexes conditionnés. Qu’on soit entièrement, partiellement ou pas du tout d’accord avec son propos, son nouvel essai, Professeurs de désespoir, oblige dans chaque cas à se demander pourquoi : en cela, il constitue une précieuse machine à lancer des débats de fond, à faire avancer la question - rarement posée, finalement - de la conception que l’on a de la littérature.
Lorsqu’une des romancières françaises les plus connues ne se contente plus d’écrire des romans - ce pour quoi on l’encense ou du moins la tolère -, mais prétend expliciter, dans un essai, les présupposés et les options philosophiques qui sous-tendent son travail, et qui la mettent en porte-à-faux avec des auteurs chéris par la majeure partie de la critique, elle se retrouve soudain dans une position de quasi marginalité. Star de la fiction, Nancy Huston est, parallèlement, une essayiste « périphérique », au sens qui nous intéresse, c’est-à-dire au sens d’une charge contestataire qui interpelle le « centre » et l’invite à une remise en question. Elle tente d’enfoncer un coin de ce qui, dans la psychologie collective, résiste le plus ; elle s’entête à poser le doigt là où ça coince, à secouer le cocotier de nos réflexes conditionnés. Qu’on soit entièrement, partiellement ou pas du tout d’accord avec son propos, son nouvel essai, Professeurs de désespoir, oblige dans chaque cas à se demander pourquoi : en cela, il constitue une précieuse machine à lancer des débats de fond, à faire avancer la question - rarement posée, finalement - de la conception que l’on a de la littérature.
Tous ceux qui ont un jour tenu entre leurs mains l’un de ses romans, et qui en sont ressortis essorés, sens dessus dessous, savent que s’il y a une chose qu’on ne saurait lui reprocher, c’est bien de présenter une vision idyllique de l’existence. Ce qui fait sa force, c’est sa manière de sonder les gouffres de l’âme humaine, de disséquer les douleurs les plus insupportables, sans jamais cesser de tenir farouchement à la vie et d’en capter les moindres éclats de beauté. « Je veux pouvoir tout voir », disait-elle dans un entretien, et elle voit tout, en effet : le désespoir le plus noir, les éblouissements les plus purs, et l’infinie gamme de nuances qui se déploie entre les deux.
« Comme le génie est toujours excessif,
on prend leurs excès pour du génie »
Le problème, c’est qu’il y a dans la mentalité contemporaine une très forte tendance à considérer que, pour produire de la vraie littérature, de la littérature au sens le plus noble du terme, il est impératif de balancer le nuancier par-dessus bord. Si on relit ce qui précède, les termes « éblouissements les plus purs » et « éclats de beauté » ne suscitent-ils pas une méfiance instinctive ? Ne se rendent-ils pas immédiatement suspects de niaiserie insipide, de naïveté béate ? Les écrivains portés aux nues par la critique sont bien souvent ceux qui ne conservent de ces énoncés que les « gouffres de l’âme humaine » et les « douleurs les plus insupportables ». A l’exclusion de tout le reste. Concéder le moindre attrait à l’existence, c’est se discréditer.
Dans Professeurs de désespoir, Nancy Huston examine et conteste la vision du monde commune à plusieurs écrivains nihilistes, ou « néantistes », morts ou vivants, dont elle relève avec perspicacité les caractéristiques biographiques communes : Arthur Schopenhauer (dont les suivants sont de grands admirateurs), Emil Cioran, Thomas Bernhard, Samuel Beckett, Milan Kundera, Elfriede Jelinek (l’auteure de La pianiste), Michel Houellebecq, Christine Angot, Sarah Kane... Parmi eux, il en est dont elle reconnaît la valeur littéraire, voire qui font partie de son panthéon personnel (Beckett), et d’autres qui la laissent sceptique. Mais notre société, en général, ne s’encombre pas de telles distinctions : Huston montre bien comment la radicalité dans la noirceur, qu’elle soit sincère ou relève de la pose, qu’elle donne naissance à des chefs-d’œuvre ou à des romans à quatre sous, est devenue une recette infaillible pour être pris au sérieux en tant qu’écrivain. « Comme le génie est toujours excessif, on prend leurs excès pour du génie », écrit-elle des nihilistes.
Elle retrace ainsi le lent fourvoiement qui a abouti à la situation actuelle : « Hugo, Dumas, Balzac, Sand : ces auteurs vous apprenaient quelque chose sur la vie humaine, ils ouvraient des portes, fouillaient les tréfonds de l’âme, cherchaient la nuance (...). Dans un deuxième temps, pour des raisons historiques faciles à saisir, il a été admis que le message d’un roman pût être noir, simplifié, absolutiste, désespérant même, du moment que l’ensemble était “racheté” - c’est-à-dire humanisé, moralisé - par un très haut style (Beckett, Cioran, Bernhard). Mais, peu à peu, on s’est mis à confondre noirceur et excellence, à prendre la noirceur comme telle pour une preuve d’excellence. (...) Voilà le progrès : on est passé des pierres précieuses... aux diamants noirs... au tas de charbon. »
Un désespoir résultant
d’une vision du monde fruste et biaisée,
qu’il conforte en retour
Elle a beau répéter qu’il ne s’agit en aucun cas de prôner une littérature « joyeuse, guillerette et pleine d’espoir », elle n’échappera sans doute pas aux procès d’intention qui l’accuseront de vouloir interdire le désespoir en littérature. Or, ce qu’elle remet en cause, c’est plutôt la vision du monde fruste et biaisée dont ce désespoir résulte, et qu’il conforte en retour. Une vision qui pose chaque individu comme une entité indépendante, isolée, étanche ; qui postule une « coupure irrévocable entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme », et envisage la vie non comme un cycle, mais comme une « pente descendante » vers le néant : « Etant donné qu’ils [les écrivains nihilistes] ne perçoivent pas la circulation, les liens mouvants, l’échange, la transmission, étant donné qu’ils décrivent chaque individu comme une entité inamovible et close, la mort leur apparaît comme l’effacement total de l’être. »
A ses yeux, au contraire, l’être humain n’est « ni tout, ni rien », mais « un lieu d’échanges, un individu en transformation perpétuelle, ayant reçu non seulement la vie mais le langage, des rituels, des traditions, des savoirs... et susceptible (mais non obligé) de transmettre cet héritage aux autres (enfants, amis, élèves) ». Il est une entité poreuse, perméable, fluctuante, qui évolue sans cesse au contact des autres ; l’écrivain Jean Améry, qu’elle cite, évoque « le Toi, sans lequel je ne serais jamais parvenu à être un Moi ». On pense à la belle image du philosophe Nicolas Grimaldi dans son Traité des solitudes (Presses universitaires de France), qui figure dans les citations de ce site : « Simple médiation, le moi phagocyte une multitude de subjectivités différentes, s’assimile leur expérience, et compose sa propre personnalité d’imitations et d’emprunts qu’il fond en l’unité d’un style. Il faut entendre cette assimilation en un sens biologique : l’altérité s’y transmue en identité. C’est en imitant la singularité des autres que chacun construit son inimitable singularité. » Mais aussi : « A travers le moi, tout se révèle, tout se réfléchit, tout s’exprime. Mais par rapport à ce dont il se fait ainsi le médium, le moi est-il autre chose que ce qu’est une vague sur la mer ? Elle se forme de très loin, enfle, monte, se précipite, elle explose, elle se brise ; et pourtant elle n’existe pas. »
Une phobie de la chair, des liens, des sentiments,
perçus comme répugnants, kitsch, mièvres
La vie apparaît aux nihilistes comme une calamité, une malédiction dont ils rendent responsables les femmes, coupables de les attirer vers « ce piège épouvantable qu’est la vie », d’abord en leur donnant le jour, puis en les poussant à se reproduire. Ils manifestent une misogynie féroce (ce qui rend particulièrement intéressant le cas des femmes nihilistes), une phobie de la chair, des liens, des sentiments, perçus comme répugnants, kitsch, mièvres, et incompatibles, cela va sans dire, avec la création artistique, avec les nobles œuvres de l’esprit. Le « féminin pensant », le « maternel intelligent » dont Nancy Huston se fait le chantre sont des phénomènes dont, tout à leurs pauvres oppositions binaires, ils n’envisagent même pas l’éventualité.
Le corps, pour eux, constitue une humiliation inacceptable, un affront fait à la grandeur de l’esprit ; un Kundera accablé parle de « l’atelier de bricolage » dans lequel les humains ont été fabriqués, et dans lequel on a installé « une petite usine puante dans leur ventre ». Ne jugeant nullement déshonorant, pour sa part, ce mélange de nature et de culture qui est la définition même de la condition humaine, l’acceptant comme une donnée fondamentale, Nancy Huston s’interroge : « Est-ce un scandale que l’âme humaine soit piégée dans un corps ? N’est-ce pas un miracle, plutôt, que chaque corps humain recèle une âme ? »
Juger la littérature selon les critères
du désespoir adolescent
Rencontrée à l’époque où elle entamait l’écriture de ce livre, elle disait : « Plus le temps passe, plus je mesure ce que je trimballe grâce aux autres, tout ce que je contiens grâce à mes rencontres, mes amours, mes lectures, la maternité, l’amitié, les voyages... Je me sens absolument grouillante de vie. Et c’est vrai qu’à dix-huit ans, je ne sentais pas ça. J’étais un désert ambulant [rires]. Je voulais mourir ! A dix-huit ans, on est tous sartriens : on se croit solitaires, auto-engendrés. Il y a quelque chose de presque intrinsèquement adolescent dans le désespoir. » Et, en effet, parmi les écrivains étudiés dans Professeurs de désespoir, beaucoup sont des auteurs auprès desquels on trouve un réconfort paradoxal, mais réel, à l’adolescence, quand on conjugue une vision de la vie encore sommaire avec un ressentiment assez vivace à l’égard de ses géniteurs. Dans Le combat ordinaire (Dargaud), la bande dessinée de Manu Larcenet, le narrateur, qui sort de psychanalyse, constate que, désormais, il n’en veut plus à ses parents ; et il a cette réflexion : « Arrêter de chercher à mettre au jour des responsabilités, ça rend les problèmes passionnants. » De même, les adolescents, en général, finissent un jour par en avoir marre de se rouler par terre en se lamentant parce qu’ils sont nés, et parce qu’ils sont prisonniers d’un corps (que l’irruption brutale de la puberté a rendu, dans un premier temps du moins, particulièrement encombrant) ; comprenant qu’ils tournent en rond, ils envisagent de passer à autre chose, de consacrer leurs révoltes à des causes moins vaines, et élaborent peu à peu une perception plus fine et plus complexe de l’existence.
Mais ce passage à l’âge adulte, on dirait que, collectivement, notre société, ou plutôt ses élites culturelles, refuse de l’accomplir, puisqu’elle fait du désespoir adolescent un critère de valeur littéraire. Peut-être s’imagine-t-elle qu’au-delà, il n’y aurait plus que la morne plaine d’un quotidien sans histoires, qui ne donnerait plus aucun fil à retordre et ne serait donc plus source d’inspiration créatrice... Ce en quoi elle se trompe : au-delà, elle trouverait le nuancier dont on parlait plus haut, justement ; un nuancier dont le désespoir n’est pas exclu, mais où il prend d’autres formes - des formes qui font l’économie de ces visions grossières de la condition humaine. On reste songeur en pensant à tous les cas de figure passionnants qu’elle empêche de surgir, sur ce territoire inexploré dont elle met en doute jusqu’à l’existence.
Une subversion à bon marché
Là où Nancy Huston prête le flanc à la critique, cependant, c’est lorsqu’elle pointe le fossé qui sépare les valeurs défendues par la plupart des gens dans leur vie quotidienne de celles qu’ils recherchent dans l’art. Au début du livre, elle raconte une soirée au théâtre, où elle assiste à une représentation d’une pièce de Thomas Bernhard, Déjeuner chez Wittgenstein. Deux sœurs, incarnations de la « petite-bourgeoisie conformiste », y reçoivent à dîner leur frère, Worringer, un homme « furibard, caustique », qui, tout en éructant, plonge les mains dans la salade, s’essuie les doigts à la nappe et fracasse la porcelaine familiale, au grand ravissement du public : « Tonnerre d’applaudissements, à la fin... Puis chacun rentre chez soi, rejoint le monde où les liens comptent, où les objets sont symboles porteurs d’amour et de mémoire, où la courtoisie traduit le respect d’autrui, et où un malotru puéril de la trempe de Worringer serait sèchement et fermement mis à la porte. » N’y a-t-il pas un grand danger à vouloir faire coïncider ces deux registres ? C’est une question qui m’avait déjà tourmentée, malgré la finesse des analyses, à la lecture de Mosaïque de la pornographie (Payot), l’un de ses premiers essais, récemment réédité. Evidemment, les produits culturels en circulation au sein d’une société en disent long sur son état, sa mentalité, et ne restent pas cantonnés à une sphère hors du monde : ils influent sur sa vie réelle. Mais, en même temps, l’art permet tant au créateur qu’au public de donner libre cours à ses pulsions asociales, troubles, violentes, de les exprimer et de les explorer sur le mode du jeu, évitant du même coup, peut-être, qu’elles fassent trop de dégâts dans la vie réelle. Où, sinon, l’être humain pourrait-il réfugier sa part d’ombre, ou simplement ses contradictions ?
Si, malgré cela, son évocation de Déjeuner chez Wittgenstein est assassine, c’est parce qu’elle invite à sonder la portée des subversions de ce genre. Son récit de sa soirée au théâtre me ramène irrésistiblement à une projection de Boudu sauvé des eaux, de Jean Renoir, lors d’un festival de cinéma dans le Sud-Ouest auquel tous les invités se rendaient avant tout (uniquement ?) pour les bonnes bouffes et les dégustations de grands crus qui leur étaient offertes dans des châteaux des environs. Dans le film, un bourgeois sauve de la noyade un clochard, interprété par Michel Simon, et lui offre l’hospitalité. A table, Boudu envoie valser les plats, en répand le contenu sur le tapis... La salle se tordait de rire, enchantée. Moi, la scène m’avait laissée de marbre. Je ne voyais pas ce qu’il y avait de subversif là-dedans. Je voyais surtout la boniche de la maison obligée de se traîner à genoux pour ramasser les débris de vaisselle et nettoyer le sol : ses récriminations augmentaient encore la joie des spectateurs. J’avais juste trouvé ça affligeant. Plus tard, en constatant avec ébahissement combien les individus les plus radicaux, iconoclastes et tonitruants, ceux qui me faisaient sentir, en comparaison, si frileuse, bourgeoise et timorée, pouvaient s’avérer, dans les circonstances importantes, conformistes, pleutres et lâches, j’ai complètement cessé d’être complexée par ma réaction devant Boudu - mais c’est une autre histoire.
« Les sujets dont personne
ne veut entendre parler »,
vraiment ?...
La force du livre est ainsi de nous faire changer de perspective sur les écrivains nihilistes, dont le prestige tient pour une bonne part (voire, pour ceux d’entre eux qui sont de piètres écrivains, entièrement) à l’illusion qu’ils sortent de l’ordinaire, qu’ils se démarquent du commun des mortels : Nancy Huston montre au contraire que ces gens, au fond, disent tous la même chose, au point, souvent, de ne faire que ressasser un tout petit nombre d’antiennes susceptibles d’épater le public. Par exemple, elle relève, parmi leurs tics, la coutume qui consiste à commencer un livre par l’annonce détachée de la mort d’un parent - « ma mère est morte, mon père est mort, je m’en fous, les liens ne signifient rien pour moi, les familles c’est de la merde, je suis libre » : c’est le cas dans Premier amour et Molloy de Beckett, dans L’Etranger de Camus, L’Extinction de Bernhard, Plateforme de Houellebecq... On peut présumer qu’après en avoir pris conscience, quand on se retrouvera confronté à ce procédé, on aura tendance à en sourire, plutôt qu’à trouver ça décoiffant et à se sentir minable quand on n’est pas soi-même capable de la même indifférence. De même, Nancy Huston cite Houellebecq, qui conseille aux aspirants écrivains de faire comme lui et de « creuser les sujets dont personne ne veut entendre parler. L’envers du décor. Insistez sur la maladie, l’agonie, la laideur. Parlez de la mort, de l’oubli ». Et elle remarque : « Nous savons maintenant que, loin d’être les “sujets dont personne ne veut entendre parler”, il s’agit là des sujets de prédilection du courant le plus puissant de la littérature contemporaine. »
« Soyez abjects, vous serez vrais », prône encore Houellebecq. Ce qui est éminemment discutable, mais voilà : les nihilistes, c’est peut-être leur plus grand mérite, ont découvert un moyen infaillible d’avoir toujours raison. Si vous contestez leur vision du monde, on pourra toujours vous soupçonner d’être moins courageux qu’eux et de ne pas vouloir regarder les choses en face (« ça ne fait plaisir à personne mais c’est la vérité », écrit quelque part Elfriede Jelinek). L’argument est pourtant réversible : où sont le vrai courage, la vraie radicalité ? Dans le fait de proférer des énormités intellectuellement indigentes, mais à la séduction facile, d’en rajouter dans la noirceur pour plus de sûreté, ou alors, dans le fait de s’exposer en connaissance de cause au soupçon de couardise et de tiédeur pour contester ces déclarations fracassantes et défendre la nuance - programme aussi ingrat que juste ? Dans l’obsession de se démarquer à tout prix de ses semblables (obsession si répandue que Huston parle de « grégarité élitiste »), ou dans la capacité à assumer la banalité, parfois, de sa propre vie, de ses propres désirs ? Dans le rejet orgueilleux de la chair, ou dans son acceptation sereine et heureuse ? Nancy Huston rend hommage à Charlotte Delbo, rescapée d’Auschwitz, qui adresse à ses contemporains cette sublime prière : « Vous qui passez / bien habillés de tous vos muscles (...) / animés d’une vie tumultueuse aux artères et bien collée au squelette / vous êtes beaux / tellement beaux d’être quelconques. »
« Les femmes tremblent »
Dans la postface d’un autre livre chroniqué ici, et qui n’a rien à voir avec le travail de Nancy Huston, Femmes, magie et politique, de Starhawk, Isabelle Stengers affirmait la nécessité, si on voulait avancer, d’abandonner les poses valorisantes mais stériles, et de « prendre le risque de faire ricaner ». Ce risque, ce goût de l’aventure quoi qu’il en coûte, Nancy Huston les assume avec panache. A la différence de beaucoup d’hommes, écrit-elle, « les femmes tremblent » et doutent d’elles-mêmes lorsqu’elles doivent s’exposer ou défendre des positions à contre-courant. Il est d’autant plus passionnant de les voir échapper à cet effet d’intimidation - lui échapper au moins assez pour qu’il ne les dissuade plus de parler, de se rebiffer, d’affirmer leur désaccord.
Ce livre, parce qu’il plaide la cause de toutes ces réalités de la vie qui suscitent une répugnance très ancrée - les liens, les sentiments... -, et parce qu’il rappelle que le fait de voir un enfant grandir peut aider à comprendre qu’aucune personnalité ne saurait se constituer sans liens ni sentiments, justement, donnera sans doute de l’urticaire à beaucoup de critiques misogynes. Premier à avoir mordu à l’hameçon : Michel Polac. Dans Charlie Hebdo (22 septembre 2004), révulsé qu’on veuille l’obliger à « s’attendrir devant les sourires baveux et les zozotements des bébés » (quelle horreur !), il ironise (et délire) : « Ah, les petits oiseaux, les petites fleurs, Sœur Emmanuelle et les chiffonniers du Caire, les gracieuses danseuses indiennes, etc., etc. » Pour le reste, il n’a visiblement rien compris au livre. Le désespoir de ces auteurs, nous apprend-il (il les connaît évidemment bien mieux que cette gonzesse qui ose venir contester l’autorité de la critique virile et désabusée), n’est pas du désespoir, mais de la « lucidité » ; il est absurde de les qualifier de « professeurs », car ils n’ont « pas de philosophie » - or, tout le livre démontre qu’ils en ont une, au contraire, même si elle n’est ni consciente, ni délibérée... Mais de toute façon, qu’attendre d’un personnage dont la chronique hebdomadaire, sur France Inter, débute par ce fameux dialogue de Pierrot le Fou, de Godard, dans lequel l’héroïne braille « Qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi faire ! », jusqu’à ce que son compagnon excédé lui intime : « Silence, j’écris ! » ? D’un personnage qui a donné toute la mesure de sa muflerie et de sa suffisance le jour où il a basé sa piètre appréciation de La vie sexuelle de Catherine M. sur le fait que Catherine Millet lui paraissait « ressembler à Agnès Varda, que j’aime beaucoup, mais pas particulièrement pour son physique » (Charlie Hebdo, 18 avril 2001) et sur le fait qu’il ne trouvait au livre « rien d’excitant » - autant le savoir, il y a encore des types qui se prétendent arbitres du bon goût littéraire et pour qui le livre d’une femme qui parle de sexe ne saurait être bon s’ils ne le trouvent pas « excitant » et si son auteur ne les aguiche pas ?
Dans Professeurs de désespoir, Nancy Huston formule une hypothèse intéressante : la vogue de la littérature « néantiste » traduirait « un sursaut de virilisme » inspiré par l’angoisse des hommes modernes devant le constat que les femmes remettent désormais en cause leur monopole sur le monde de la pensée et de la création...
Merci à Dominique Brancher
Nancy Huston, Professeurs de désespoir, Actes Sud, 384 pages, 23 euros.
Sur le(s) même(s) sujet(s) dans Périphéries :
- * Rêver contre soi-même - Triomphe de l’imaginaire de droite, faiblesse de l’imaginaire de gauche - 28 mai 2007
- * Les aveuglements de la lucidité - Retrouver l’Océan, d’Henri Raynal - janvier 2006
- * Le « sentiment océanique » à l’assaut du rationalisme - Traité d’athéologie, de Michel Onfray
La mystique sauvage, de Michel Hulin - mars 2005 - * Penser sans entraves - Annie Leclerc, philosophe - octobre 2003
- * L’entremêleuse - Nancy Huston, romancière et essayiste - juin 2003
- * Le sens du futur - 10 janvier 2001






